24/04/2015
L'âge du polémolithique - Le 24/04/2015

« Finalement, c’est la frontière entre l’état de guerre et l’état de paix qui disparaît, puisque les guerres ne font plus l’objet d’une déclaration en bonne et due forme, et qu’elles se poursuivent une fois que les armes se sont tues, par le biais des diverses formes de « réparations » ou de « rééducation » des populations. » Cette phrase d’Alain de Benoist prononcée lors d’un entretien rappelle ce que Steinbeck prévoyait après sa couverture de la guerre du Viêtnam, à savoir que « la politique est désormais la prolongation de la guerre par d’autres moyens ». On reconnaît l’inversion de la phrase du polémologue Clausewitz mais ce n’est pas qu’une simple pirouette. Steinbeck note dans les années soixante que la guerre pénètre tant la polis que celle-ci en devient l’extension permanente voire l’instrument. Selon lui, c’est ce qui signale le basculement dans la modernité.
Ses DEPECHES DU VIETNAM sont de beaux mémoires de guerre. Parti en Indochine en tant que reporter, il y raconte ses journées en territoire Viêt-Cong aux côtés de GIs hallucinés. Il passe au Cambodge et en Thaïlande où il impressionne par sa capacité à saisir la totalité de l’Indochine en à peine quelques semaines. Sa femme est aussi de la partie ainsi que son fils qui est un marine. Le protéger à distance, comme si la présence du père jouissait d’une mystique maternelle, n’est pas la moindre raison d’un voyage entrepris à déjà soixante ans, mais peu à peu, elle s’efface devant l’Histoire qui dépasse celle de Steinbeck. Grand classique du coin : l’américain succombe au mythe de l’écrivain occidental tout aux charmes de l’Asie. Moite et folle, la terre du Mékong vit de sa guérilla : insaisissable comme les soldats d’Ho Chi Minh planqués dans leurs tunnels, il est impossible de l’arpenter, alors Steinbeck surplombe le front de jungle depuis les hélicoptères dont il apprécie la maniabilité et les pilotes habiles. Puis c’est l’homme qui domine le ciel par la technologie lorsqu’il entend la rumeur des mitrailleuses embarquées.
D’abord convaincu du bien-fondé de l’intervention américaine, le californien sort de l’aventure meurtri dans sa chair et dans sa foi. Il mourra bientôt. Ses papiers seront son dernier opus. A l’issue de son reportage, s’il continue d’admirer la force des armes et le courage des jeunes ricains, il respecte autant le Viêt-Cong qu’une Indochine qu’il tient en haute littérature.
Des paysages hypnotiques, l’américain a tiré de profondes réflexions sur l’avenir de la guerre et plus largement sur celui du monde qui sera en proie au conflit total. Total parce que international : depuis la guerre du Pacifique qui s’est poursuivie en Corée, les USA peuvent se projeter dans l’instant en n’importe quel point du globe ; mais surtout parce que le conflit moderne touche les sociétés entières, des civils aux militaires (ce qui n’est plus nouveau depuis la Première Guerre Mondiale) en s’adjoignant les artistes et les médias d’image plus que de presse (ce qui est la nouveauté du Viêt-Nam).
Dans le film APOCALYPSE NOW, les marines dansent sur le Mékong au son des Rolling Stones qui trouvent zéro satisfaction ailleurs que dans cet instant culte où la politique s’annule dans la guerre. C’est bien celle-ci qui réclame une politique que toute une « culture occidentale » s’empresse de lui servir en continu et en chanson. L’art de la guerre doit être compris comme l’art au service de la guerre, c'est-à-dire qu’il n’est plus une fin mais un moyen. La guerre n’a plus besoin de stratèges mais de pitres. Charge leur incombe de communiquer. Au bruit des armes s’ajoute donc celui des guitares et des batteries nécessaires à la justification d’un impérialisme festif. La télévision introduit les batailles par le jingle.
Plus tard, le film GREEN ZONE montre un lieu sécurisé au beau milieu de Bagdad. Cette fois, les soldats s’ébrouent dans une piscine sur fond de musique de boîte de nuit. Ils font de la musculation et biglent des bimbos de clip RNB. Bientôt viendra une sortie grandeur nature pour aller dessouder à la façon d’adolescents à l’assaut de leur rut. Comme la politique qu’elle instruit, la guerre occidentale ressemble à un spring break.
Que « la politique est désormais la prolongation de la guerre par d’autres moyens », la société d’ISIS la peste en est une parfaite illustration. Le terrorisme y est un principe d’état qui s’exporte via ses kamikazes festifs : ces erroristes1 éclatent plus qu’ils ne se font éclater. Il n’est que de voir les faces réjouies des djihadistes en train de brandir les têtes qu’ils viennent de trancher. Il existe une photographie d’un barbu tout sourire en train de tenir par les cheveux la tête d’une kurde coupable à ses yeux d’avoir tué cent de ses frères pour défendre sa communauté. Le type est bien mis, tout beau tout propre, bientôt écolier, pas sauvage pour un sou, or c’est précisément ce qui le rend barbare : le raffinement mis à photographier sa trogne de joie, après avoir tué, établit le recul de l’humanité au stade de ses instincts. Le soldat est l’enfant bobislamiste de la guerre festive. Il est pareil à ses petits copains qui mettent en scène une pornographie de l’assassinat au moment d’étêter leurs prisonniers. En direct. Ces images et ces selfies servent autant une propagande qu’elles créent l’idée d’une mort esthétique qui serait supérieure à la vie. La mort devient une fête et c’est celle-là qui est désormais la prolongation de la politique par d’autres moyens.
En Europe, règne une guerre des mœurs qui investit la politique via ses chansonniers rigolos. Je pense à Conchita Wurst ou aux Enfoirés. Car la France n’est pas en reste : patrie des droits de l’homme, elle s’émeut au souvenir de la racaille de 1789 par qui s’est larvée sur le territoire une guerre civile tel que l’explique l’écrivain Richard Millet dans ses chroniques commencées en 2015. En leur nom, des droits de l’homme, la guerre des mots commande une politique de l’erreur mentale qui braque les intelligences. Principe universel oblige et déclaration européenne de 1948 exige, c’est l’UE-US qui croupit dans cette philosophie. Partout, s’étend un errorisme moral qui fabrique ses erroristes mentaux. Errant parmi les ombres, ils sont les radicaux libres d’une société dont l’atomisation est renforcée par l’urgence du coup d’éclat permanent.
Louis Pauwels parlait en 1986 de sida mental qui commençait de gangrener les esprits. Ces derniers s’unissent à l’international tantôt via un idiot télé rompu à la guéguerre cathodique ; tantôt par un pisse-copie que la critique qualifie d’engagé ; tantôt par un haut dirigeant qui viole une femme de ménage ; tantôt par un taré de DAESH ou son envers, l’énervé de l’acte selfie qui est Lubitz ou Breivik ou Merah ou Coulibaly ou lui-même.
Cependant, la guerre par les armes existe aussi par l’UE-US qui milite pour la démocratie sous les bombes. Irak, Afghanistan, Libye et Corée et Viêtnam avant eux – tous pays mis à la panade polémocratique, cette démocratie militaire que ses oxymores bouffissent d’imposture. Et toujours, les artistes à neuneu assurent le chœur médiatique qui mène l’effort de guerre culturel afin de laver les opinions à leurs idéaux. C’est BHL en coryphée qui piaille LIBERTE. Et les drones assurent le sale boulot moyennant des frappes chirurgicales.
1. voir ma chronique du 01/04/2015 : L'homme qui voulut voir les hommes d'en haut - Le 01/04/2015
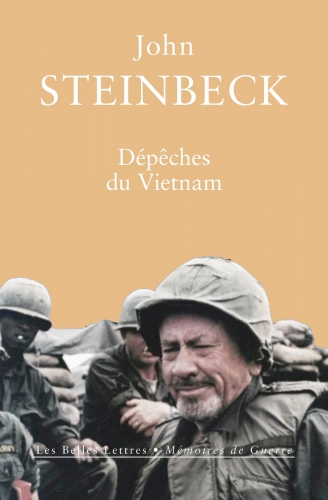
L'Aristo dit que c'est un livre à lire pour dépasser Clausewitz et Sun-Tzu qu'il faut lire aussi.
18:59 | Lien permanent | Commentaires (0)



Les commentaires sont fermés.